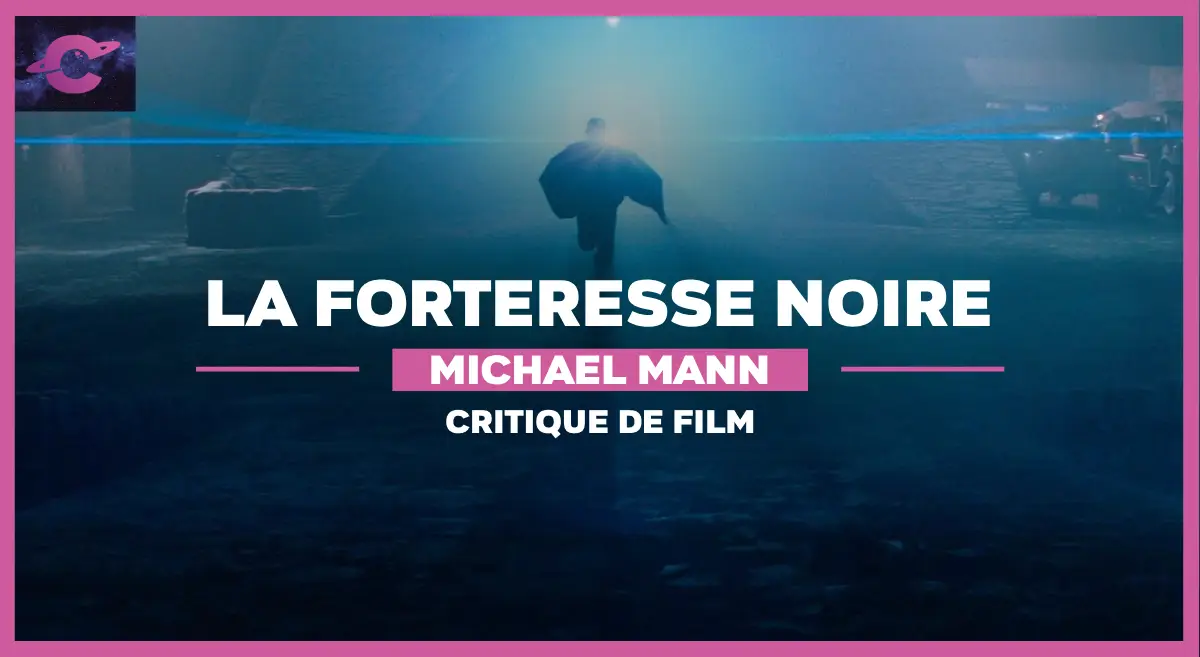Avec la ressortie en 4K de La Forteresse noire chez Carlotta, le public français va enfin avoir l’occasion de (re)découvrir dans une définition flambant neuve le deuxième film de Michael Mann. Une œuvre malade désavouée par son auteur, qui mérite pourtant le coup d’œil.
Après des débuts remarqués à la télévision et un premier film salué à Cannes en sélection officielle (The Thief) , Michael Mann choisit de quitter les sentiers balisés du polar urbain qui a fait sa renommée pour s’aventurer sur des terres plus incertaines : l’adaptation d’un roman fantastique, La Forteresse noire, réinterprétant le mythe du Golem. Un pari audacieux, mais vite rattrapé par une production chaotique et un genre dans lequel le cinéaste peine à trouver ses marques malgré une minutie formelle à couper le souffle.
« Durant la Seconde Guerre mondiale, un détachement de soldats allemands prend ses quartier dans une ancienne citadelle roumaine perdue dans la montagne. Malgré les mises en garde de la population locale qui tient la forteresse pour hantée par une force étrange, les hommes de guerre obéissent aux ordres de leurs supérieurs et s’installent à demeure. »

Nuit et brouillard
En comparaison à 1982 et 1984, 1983 fait pâle figure. Certes, David Cronenberg aligne coup sur coup deux films majeurs (Videodrome et Dead Zone), Superman et Jaws en sont à leur troisième itération, l’Etoile de la Mort ressuscite pour clore l’année en beauté. Mais en dehors de cette poignée d’événements, peu ou pas de quoi émoustiller une quelconque rétine un brin plus exigeante. 1983 est une année de digestion et de prélude, une transition. La même que celle que s’accorde Michael Mann avec La Forteresse noire en profitant de l’engouement général pour le genre, mais aussi celui qu’il connait auprès de la presse et des studios.
Dès l’ouverture, le cinéaste déploie une de ses futures marques de fabrique : une scène totalement muette et empreinte de contemplation. Mann y installe son atmosphère, pose les briques de sa forteresse. Il étale ses talents clipesques avec nombreux ralentis – qui montreront rapidement par la suite leur limite.
En l’espace de trois minutes, on baigne dans une ambiance planante. La caméra glisse du ciel vers la terre, nous précipitant dans les Carpates – territoire du plus célèbre vampire -, enveloppé de brumes épaisses qui hanteront l’ensemble du film et ne sont pas sans rappeler l’expressionnisme allemand. Un style qu’empreinte Mann à ses débuts et qu’il abandonnera par la suite pour adopter des références plus américaines.
En outre, pour ajouter de la matière à l’ensemble, le réalisateur s’associe encore à Tangerine Dream. Un groupe qui, après avoir électrisé la scène synthé des années 70, amorce une décennie plus tard un virage vers le cinéma. Leur partition, poisseuse et entêtante, berce ce prologue vaporeux tout en annonçant l’angoisse souterraine à venir – le mal dort encore. Mise en scène et bande-son fusionnent, s’enroulent, et nous cramponnent instantanément à notre siège. Bienvenue dans le cauchemar des nazis.
Syndrome de Stendhal
Pour sa première incursion dans le genre, Mann déploie déjà la méticulosité qui sera sa signature. Chaque cadre est réellement soigné, à l’instar de sa maîtrise scénographique et de sa mise en perspective, témoignant d’un réel souci du détail visuel. Le cinéaste utilise même le 35mm dans des espaces volontairement resserrées.
Une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de Tarantino avec son 70mm sur Les Huit Salopards, où le format large du Panavision vient paradoxalement écraser davantage les personnages dans un huis clos sans échappatoire, bloquant toute ligne de fuite. Car La Forteresse noire n’est rien d’autre qu’une pirouette cathartique : celle de renvoyer les nazis à leur propre monstruosité, en les enfermant dans un espace concentrationnaire (une forteresse-prison) qui fait écho à l’horreur qu’ils ont eux-mêmes façonnée.
The Brutalist
Laissons de côté, l’espace d’un instant, les avertissements de Claude Lanzmann sur la manière de représenter la Shoah, pour admirer la mise en scène allégorique de grand spectacle que nous offre Mann. Mais aussi le colossal travail de la photographie signé Alex Thomson – déjà à l’œuvre sur Excalibur l’année précédente, et familier des univers fantastiques. Son art de la lumière confère au film un somptueux jeux de clair-obscur, qui participe pleinement à l’aura cauchemardesque du film.
Thomson prend un malin plaisir à détourner, par son éclairage, les codes de mise en scène que les nazis utilisaient dans leurs propres dispositifs d’horreur à l’arrivée des prisonniers dans les camps. Il renverse à nouveau les rapports de pouvoir et donnant au cinéma sa revanche sur sa réappropriation abominable. Le cinéaste se repose donc sur son chef-opérateur pour délivrer son message. A l’image de cette forteresse, que le chef de la section armée décrit lui-même comme « construite à l’envers », le film se retourne lentement contre ses occupants, ceux qui croyaient pouvoir voler son trésor.

Heart of Darkness
Passée une première partie prometteuse, le film révèle malheureusement ses limites. Et si la seconde parvient encore à tenir debout par la seule présence de son équipe technique et de son casting, son final (avec l’incarnation du monstre), quant à lui, s’effondre sous le poids de ses propres fondations. En revisitant le mythe du Golem, figure emblématique du folklore juif, La Forteresse Noire persiste dans son mouvement de boomerang vengeur qui finit par tourner en rond et freiner toute sa vélocité.
En effet, bon nombre de cinéastes se sont cassés les dents à tenter d’insuffler à leur film une empreinte lovecraftienne. Et Mann ne fait hélas pas exception à la longue liste des loupés. L’innommable si caractéristique du reclus de Providence finit par prendre forme sous les traits d’un monstre tout droit sorti d’un placard de SVT, et la peur se dégonfle en même temps que son mystère. Ne reste plus qu’un sac d’os sans véritable chair.
Ainsi, la forme prend le pas sur le fond pour tenter de sauver les meubles. Le fil conducteur se noue dans tous les sens, mélangeant l’ordre des priorités des intrigues au petit hasard (le film peine à trouver son héros qui porte l’enjeu) sans considération visible pour toute forme de fluidité narrative ou de bon sens dramaturgique. Un scénario mal fagoté qui incombe probablement au découpage approximatif et brutal du studio d’un film d’une durée initiale de 3h30 ! Un mal pour un bien ? La réponse restera à jamais emmurée dans les couloirs d’argiles de La Forteresse noire.