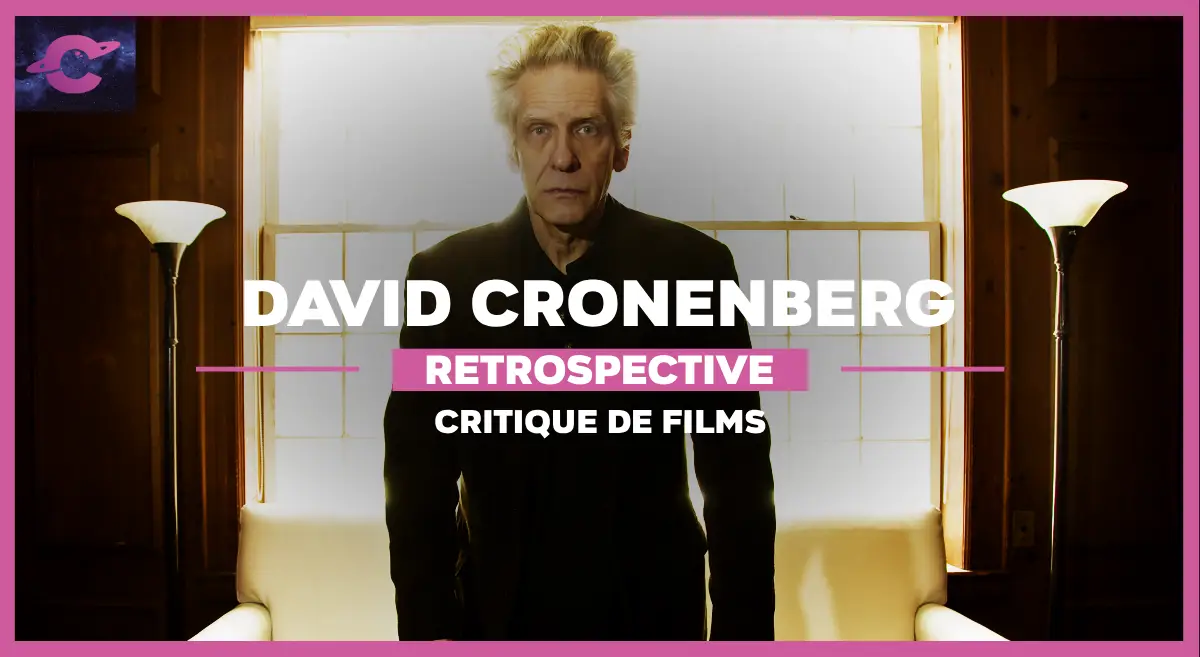Le 30 avril, David Cronenberg revient sur nos grands écrans avec Les Linceuls. L’occasion de revenir sur les court-métrages qui ont annoncé, porté ou précisé son style.
David Cronenberg est de ces réalisateurs si prolifiques qu’il n’est aisé, pour quiconque, d’atteindre le 100% de films vus sur Letterboxd. Plus tôt dans l’année, la Cinémathèque française rendait hommage au canadien en organisant une rétrospective de son oeuvre – et, pour marquer le coup, l’invitant à tenir une leçon de cinéma. La programmation ne s’était pas limitée à ses longs-métrages, et s’était étendue à ses oeuvres courtes et même les quelques téléfilms qu’il avait réalisés pour la télévision canadienne.
Long live the new flesh, surgery is the new sex… si on réduit souvent le cinéma de Cronenberg au body-horror, la ligne éditoriale reste guidée par cette obsession d’un futur inorganique appelé à supplanter le vivant. N’ayant pas pu mener à bout tous ses projets de long-métrages, le cinéaste a néanmoins su concrétiser ses visions dans ses films courts. Fenêtres sur la créativité d’un réalisateur émancipé des grandes structures de production, ces oeuvres méconnues du grand public aident à comprendre un artiste lui-même opaque.
Transfer (1966)
Synopsis : « Un psychiatre (Mort Ritts) et son patient en manque d’attention (Rafe MacPherson) discutent de leur relation au milieu d’un champ couvert de neige »
Il est toujours amusant de revenir aux sources d’un réalisateur en regardant son premier film. Dans le cas de Cronenberg avec Transfer, il y a aussi quelque chose de rassurant. Concrètement, rien ne va ; ni la focale, ni le son, ni les dialogues (quand on les entend). On peut, comme quoi, toujours revenir de loin.
On retrouve pourtant déjà les plus grand thèmes cronenbergiens. D’abord, le plus évident, la psychanalyse et l’organique. Pas encore de body-horror dans Transfer, mais des panneaux titres construits à partir de ce qui ressemble à des formules de biologie. Pas étonnant, quand on sait que le réalisateur étudiait les sciences de la vie avant de se lancer dans le cinéma. Et pas n’importe lequel ; un cinéma qui éviscère les corps, autopsie l’organique, dissèque la matière vivante.
Amateur mais déjà mature, on ne regarde pas vraiment Transfer comme un simple court-métrage étudiant à la forme un peu chaotique. D’ores et déjà marqué par un style et des sujets aussi singuliers qu’assumés, le projet porte le présage d’un grand réalisateur en devenir.

The Italian Machine (1976)
Synopsis : « Un groupe de fans de motos est déterminé, par tous les moyens nécessaires, à mettre la main sur une Ducati 900 Desmo SuperSport qui appartient à un homme riche. »
A la carrosserie nettement plus aboutie que celle de Transfer, que dix ans séparent, The Italian Machine annonce un autre thème majeur du cinéma de Cronenberg : la technologie comme fétichisme. On y discerne les rouages de Fast Company, qui sortira trois ans plus tard, en 1979.
Bazardé, le décor unique, signe de la production fauchée. Dans The Italian Machine, les personnages quittent toujours une pièce pour en rejoindre une autre. Un garage, une piscine intérieure, une galerie d’art… Mais dans cette multiplicité de lieux, l’action ne dérape ni ne cale. Tout circuite autour de cette moto, et ses courbes suaves qui suscitent l’obsession d’un groupe de passionnés.
A ce moment de sa carrière, David Cronenberg est déjà passé au long-métrage. The Italian Machine est justement le signe de cette maîtrise acquise. Les répliques s’assènent comme des coups de scalpel, la mise en scène fait drifter la caméra dans mouvements bien huilés.

Four unloved women, adrift on a purposeless sea, experience the ecstasy of dissection (2023)
Disponible sur Mubi, cette expérimentale fresque de l’organique se déploie au rythme de la houle et de lascifs murmures féminins. Le regard ondule sur les viscères érotisés de ces cires anatomiques du XVIIIème siècle. Four unloved women […] dérivent entre la nouvelle chair et la sexualité chirurgicale des Crimes du Futur.
A la croisée des grands thèmes cronenbergiens, le court-métrage exemplifie l’esthétique du réalisateur. Érigées en fétiches, les mutations corporelles et l’organique s’exhibent dans toute leur plasticité.

Camera (2000)
Synopsis : « Alors qu’un acteur vétéran (Leslie Carlson) se lamente sur l’état du cinéma actuel, un groupe d’enfants se faufile dans son appartement avec une caméra Panavision et décide de faire un film »
Au tournant du XXIème siècle et de la carrière de Cronenberg, peu à peu dirigée vers le drame social, Camera intervient comme un témoignage de ce virage entre deux temps. Leslie Carlson, évoque un virus transmis par le cinéma, mentionne le vieillissement des caméras comme l’on parlerait d’un grand-parent. « Photography is death », il affirme.
Cronenberg n’est pourtant pas phobique du numérique. De même, le regard qu’il pose sur son protagoniste n’est pas tendre. Au contraire : la texture contrastée du caméscope accentue la béance de ses rides, des tâches qui tuméfient sa peau. Aux plans rapprochés sur le visage de l’acteur, toujours seul à l’image, s’opposent ceux sur les enfants. Les tremblements de la caméra à l’épaule répondent à l’agitation juvénile des petites mains qui découvrent les machines.
Ode singulière aux innovations techniques du cinéma, Camera surprend aussi par son émotion. Le style cronenbergien, d’habitude hermétique à tout sentimentalisme, se donne ici une nouvelle envergure. Le regard final de l’acteur à l’objectif ouvre le vertige d’un homme qui discerne sa mort dans les recoins du nouveau monde.
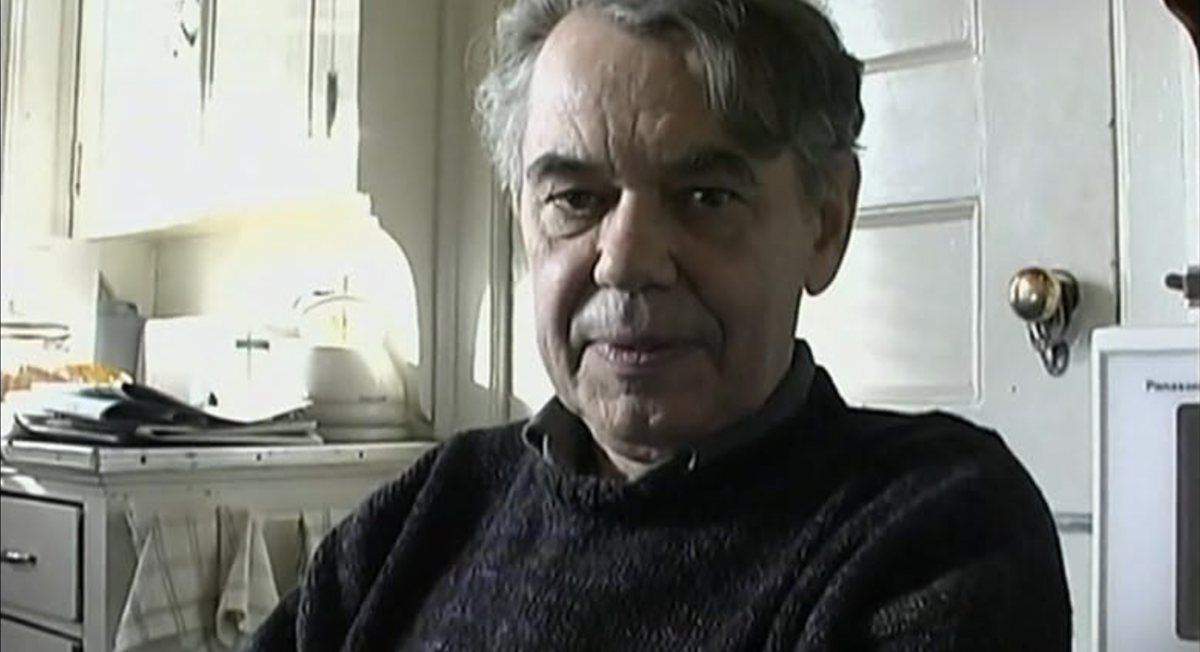
At The Suicide of the Last Jew in the World at the Last Cinema in the World (2007)
Synopsis : « Dans un futur indéfini, un homme (David Cronenberg) va se suicider dans les toilettes d’un cinéma. Deux animateurs radio invisibles expliquent qu’il est le dernier juif, dans le dernier cinéma qui va être détruit. »
David Cronenberg endosse le rôle principal de ce segment du film collectif Chacun son cinéma, réalisé pour les 60 ans du Festival de Cannes. C’est la première fois que le réalisateur aborde son identité juive. Non sans une certaine ironie, puisqu’il se décrit lui-même comme athée. Tout du long, un seul plan, en grand angle ; et deux commentateurs, qui discutent de la scène sans s’émouvoir du personnage.
At The Suicide of the Last Jew in the World […] se lit d’abord comme un sarcasme autour de l’antisémitisme. Mais y voit surtout un thème qui n’a pas disparu du cinéma de Cronenberg : la mise en scène de sa propre mort. On la retrouve dans le plus récent La mort de David Cronenberg (2021). Comment s’est-il éteint ? On ne le sait pas, on ne nous le dit pas : on y voit simplement le canadien embrasser son propre cadavre.
La continuité entre les deux courts-métrages est celle de la maturation d’un réalisateur qui a filmé les lisières entre la vie et l’inerte. Le premier montre un homme en proie terrifié par sa propre mort. Dans le second, il l’accepte sans flancher.