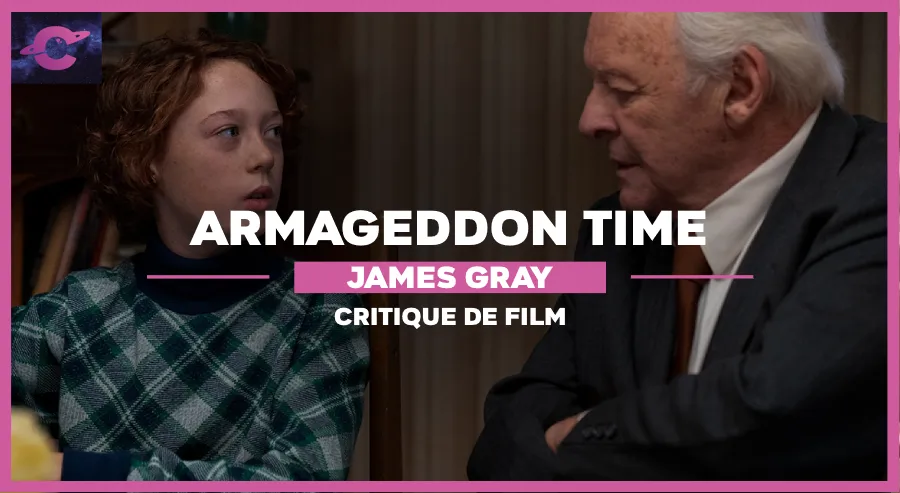Dans Armageddon Time, récit initiatique amer mais jamais doux, James Gray interroge, via le prisme des déterminismes sociaux et familiaux, sa propre lâcheté face à la permanence du mal et ses multiples visages.
Armageddon Time : A la fin des années 70, les tribulations désenchantées d’un pré-adolescent dans son quartier du Queens, entre ses aspirations artistiques et la pression familiale, entre l’antisémitisme assoupi et le racisme décomplexé, entre les handicaps sociaux des uns et les privilèges des autres.

Gray Vs Spielberg
On pourra s’amuser à recenser les points communs entre Armageddon Time et The Fabelmans. Deux récits initiatiques (même si le premier est plus ramassé dans le temps), dans lesquels le héros s’oppose à une partie de sa famille qui ne voit dans sa vocation artistique qu’un hobby, un decorum judaique, et deux films qui s’inscrivent frontalement dans la filmographie de leur auteur. Si Steven Spielberg semble s’y réconcilier avec son traumatisme, et accepter la lecture qu’on offre – parfois un peu trop facilement – d’une œuvre façonnée par le divorce de ses parents.
Ici James Gray, via ce récit largement autobiographique, retourne aux origines d’une filmographie marquée par le poids du destin, fusse-t-il familial, social ou religieux. Il aborde aussi, via son alter-ego fictionnel, ses propres doutes et déceptions. Paul Graff, jeune héros du film, est un enfant particulièrement arrogant, plutôt antipathique et moyennement talentueux, ce qui fait écho à un réalisateur qui, au moment de la sortie d’Ad Astra, s’avouait « déçu par lui-même » et de n’avoir pu approcher « l’excellence dont il rêvait ».
« Bourgeois malgré lui »
Il y a en fait deux Armageddon dans le film. D’abord dans son acception « fin du Monde ». Fin que l’auteur situe lors de l’élection présidentielle de 1980, qui verra Reagan l’emporter, et qui est déjà en gestation dans une Amérique creuset d’inégalités qui ne demandent qu’à déferler. Formellement et thématiquement, le film est très proche de Two Lovers. Tous les deux sont centrés autour d’un appartement corseté, dédale de couloirs suffocants et symbole de destinées verrouillées, mais cette fois-ci la question des déterminismes familiaux se mélange à celle des déterminismes sociaux.
Témoin les trajectoires différentes de deux enfants dans la même école – publique, aux mêmes résultats scolaires, et coupables des mêmes délits, selon qu’ils soient issus d’une bonne famille ou orphelins, selon qu’ils soient blancs ou noirs. S’illustre ici la fin de l’idéal émancipateur de l’école auquel croient les grands-parents du héros, tous deux instituteurs : en consentant finalement à inscrire Paul dans une école privée, ils reconnaissent que sa vocation est désormais de consacrer les inégalités, et de perpétuer les dynasties familiales, tout en alimentant un récit de self-made man et d’entrepreneur (édifiant discours de Jessica Chastain dans le rôle de Maryanne Trump, « sœur de. » et future juge fédérale) pour mieux entretenir le mythe de la réussite. Comme tout personnage « grayien », Paul sera rattrapé par sa condition.

Armageddon Times Two
Mais l’Armageddon peut en cacher un autre, intra-familial cette fois, « une lutte entre le Bien et le Mal », au gré des héritages familiaux et de leur érosion. On y dépeint une famille traumatisée par l’Holocauste mais pas seulement, puisque le grand-père, incarné par Anthony Hopkins, est un fils d’immigrée ukrainienne dont les parents ont été assassinés par des cosaques antisémites (coïncidence malheureuse avec la propagande poutinienne du moment). Figure tutélaire pour son petit-fils, il est caractérisé par une intransigeance qui est celle de quelqu’un qui a vu le Mal en face. Il est d’ailleurs le seul personnage à garder tout au long du film une compassion pour la cause afro-américaine, à laquelle il s’identifie non pas parce que les noirs seraient « de nouveaux juifs », mais parce qu’il sait qu’il existe, adossée à l’espèce, une monstruosité qui finit toujours par ressurgir.
A cette solidarité horizontale, le film oppose une solidarité verticale, de communauté, incarnée par le gendre (Jeremy Strong). Faite d’arrangements et de discrètes compromissions, avec toujours la même conviction que le Mal perdure, le même souci de protéger les siens, mais avec des ambitions réduites : il n’y a plus que sa famille à sauver ; et pourvu que l’on soit, quand La Bête reviendra, du bon côté de l’enclos.
En creux, et plus largement, le film postule une culpabilité post-seconde guerre mondiale dont souffrirait l’Humanité tout entière. Comme celui du protagoniste, nombreux sont les arbres généalogiques riches de héros, de déportés, de combats ouvriers ou indépendantistes, tandis que de génération en génération se réduit le domaine de la lutte : le courage se transmet plus difficilement que la lâcheté.
Armageddon Time est disponible à partir du 16 mars en Blu-Ray et DVD chez Universal