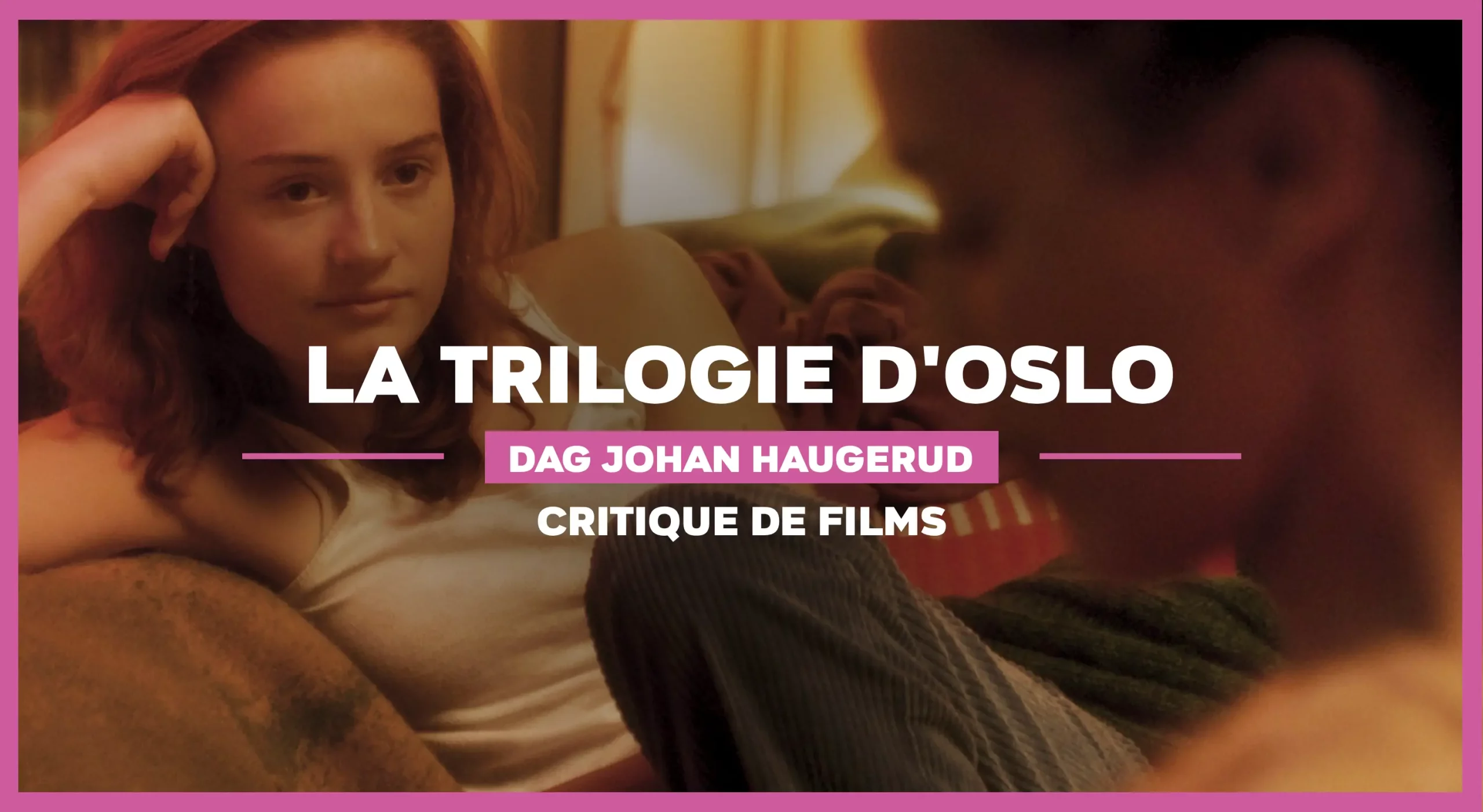Version norvégienne du réal-sociologue Bong Joon Ho, Dag Johan Haugerud ouvre avec sa trilogie d’Oslo composé de Rêves, Amour et Désir, un médium de discussion autour de thèmes forts. Les premiers émois. Les projections d’autrui sur nos vies. La quête infinie de plus de liberté.
S’il n’a pas encore la notoriété internationale d’un Joachim Trier (Oslo 31 août, Julie en 12 chapitres), Dag Johan Haugerud n’en est pour autant pas un débutant. Aussi écrivain (4 romans), il signe avec cette trilogie d’Oslo, ses 3e, 4e et 5e long-métrages après I Belong (2012) et Beware of Children (2019). Ces deux dernières œuvres avaient récolté pas moins de 13 Amanda (équivalent norvégien des Césars).
« Une jeune femme vit sa première histoire d’amour et bouscule les rêves de sa mère et de sa grand-mère. Une médecin et un infirmier confrontent leurs regards sur l’amour et ses conventions. Deux collègues ramoneurs se confient sur les interdits et les possibles du genre et du désir. À Oslo, dans les rues, sur les toits ou à bord d’un ferry, on croise tous les visages de l’intime et de l’engagement. »

Un Ours d’Or à Berlin
Contre-plongée sur un escalier de fer baignant dans la brume. Plan dans les cieux : « Ma vie tient dans un nuage », lance la voix off. Dès son ouverture, Rêves installe sa poésie, démarre son conte, qui lui a valu de rafler l’Ours d’Or à la dernière Berlinale. Il n’est pas question ici de fantastique, mais de sentiments très terriens. Vous rappelez-vous de votre premier amour ? La première fois que votre cœur a battu la chamade ? Qu’une personne a envahi vos pensées de jour comme de nuit ?
C’est ce que tente de saisir Dag Johan Haugerud dans l’œuvre qui débarque la première dans les salles obscures françaises (2 juillet). « Un premier amour, c’est déroutant, car le désir mental et le désir physique ne se déploient pas nécessairement au même rythme », explique le réalisateur.
Pour nous plonger dans ce réacteur en fusion, il articule Rêves autour d’une première partie centrée sur le personnage de Johanne (Ella Øverbye), lycéenne qui tombe amoureuse de sa professeure. Une partie qui diffère de l’ensemble de la trilogie, principalement basée sur un aspect choral, des dynamiques de duo ou de trio, propices à de longues et profondes discussions.
Le film comme médium de discussion
Et c’est là toute l’intention fédératrice d’Haugerud avec ce triptyque : ouvrir le champ des possibles, amener la discussion. Entre deux copines. Deux amants. Une mère et sa fille. Deux amis. Deux collègues de travail… Partant de là, il est presque obligatoire de voir Rêves, Amour ou Désir à plusieurs. Afin d’évoquer ensuite les éléments d’un ou de plusieurs films, qui peuvent se voir indépendamment les uns des autres. Comment aurais-tu réagi dans cette situation ? Aurais-tu pu faire cela ?
Nous sommes loin d’une série Netflix aux scènes torrides à répétition, mais plus proche d’une série comme En thérapie, où les sentiments sont dits plus que montrés. Pour une trilogie avec des titres de films comme Rêves, Amour et Désir (Sex en version originale) ceci peut surprendre. C’est un vrai parti-pris du réalisateur qui précise que « c’est extrêmement difficile de tourner des scènes de sexe réalistes. En tout cas, j’en vois très rarement. La plupart des scènes n’ont pas grand-chose à voir avec le sexe, mais plutôt avec la nudité et l’idée qu’on se fait de l’acte sexuel ».
Pas de sensationnalisme donc dans cette Trilogie d’Oslo, mais des tranches de vie de personnages que l’on pourrait rencontrer en sortant de chez soi. Toutefois, ces choix narratifs souffrent de quelques défauts. L’intrigue évolue lentement dans les trois œuvres, au fur et à mesure que les personnages se questionnent. Et si le rythme de Rêves est bien ficelé, il est moins abouti dans les deux films suivants. On le ressent par exemple dans Désir, où des moments de vies sont entrecoupés d’interludes musicaux et de plans de coupes plus proches d’un reportage télé que d’un film de fiction.

Une plume moderne tout en sensibilité et précision
La grande force de la trilogie réside dans l’écriture aiguisée de Dag Johan Haugerud, scénariste sur les trois films. Pour Rêves, il repart de l’idée qu’il avait développée aux côtés de Sonja Evang pour le moyen-métrage Det er meg du vil ha (l’histoire vraie d’une prof qui tombe amoureuse d’un élève). Et on retrouve dans Amour et dans Désir, d’autres éléments qu’il a déjà traité durant sa carrière (exemple : le héros de son premier roman travaille sur les échafaudages, alors que les deux personnages principaux de Désir sont ramoneurs).
Ce qui marque c’est la facilité qu’il a pour brosser des portraits de femmes émancipées, leurs relations – parfois conflictuelles – avec les personnes du même sexe. La facilité d’aborder des thèmes comme l’homosexualité (avec les personnages de Johanne dans Rêves ou de Tor dans Amour) ou encore les conventions sur les pratiques sexuelles (avec le personnage du ramoneur dans Désir). Même la ville d’Oslo est personnifiée et magnifiée, surtout dans Amour avec le balai incessant des ferries. Le tout rend cette trilogie moderne, sans jamais forcer le trait, sans jamais imposer une idée ou une représentation.