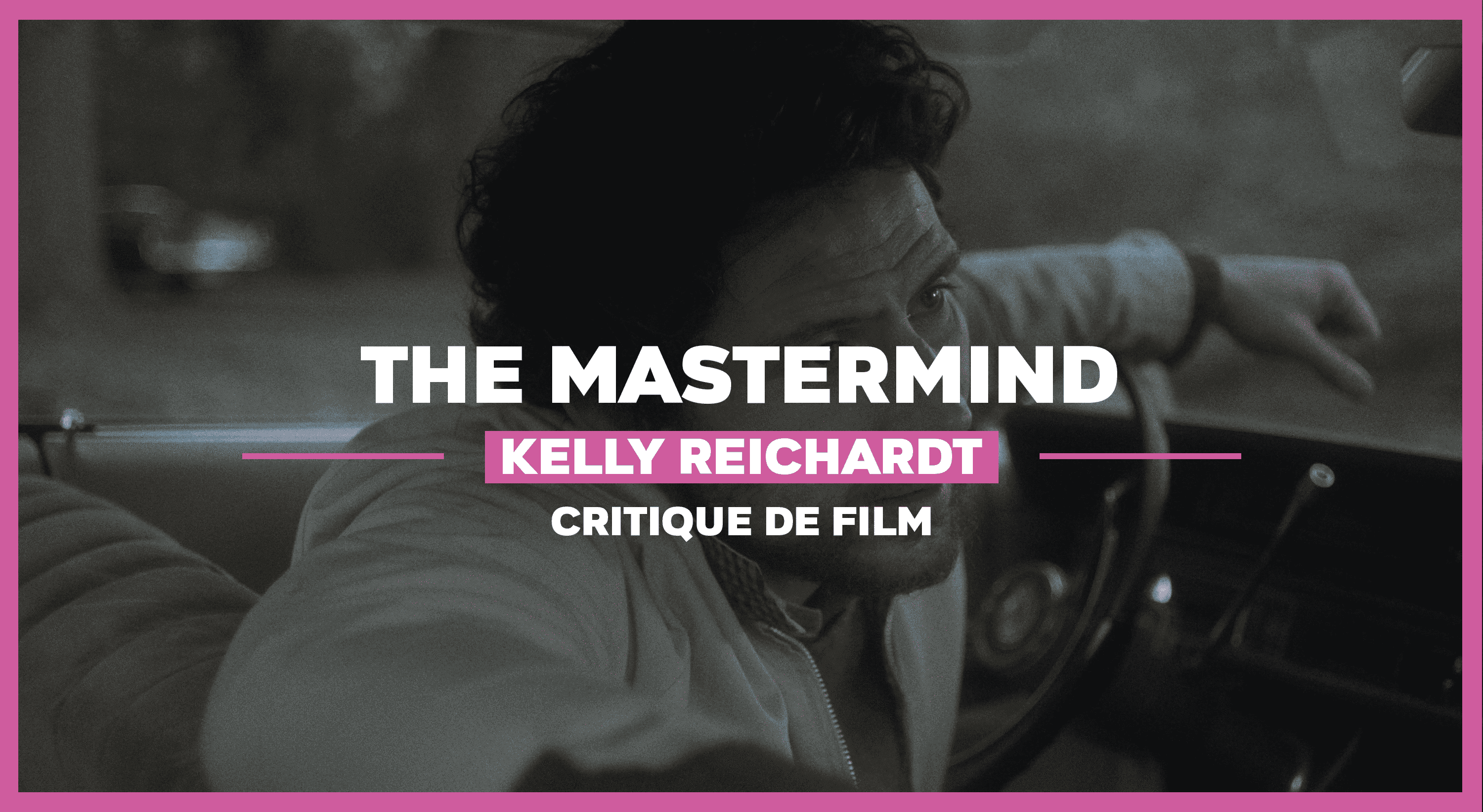Au cœur d’une exceptionnelle reconstitution historique de l’Amérique banlieusarde et surtout triste des années 1970, Kelly Reichardt s’essaie avec The Mastermind au film de braquage… à sa manière, comme d’habitude.
En compétition à Cannes l’an dernier, The Mastermind est pour Kelly Reichardt, icône contemporaine du cinéma indépendant américain, l’occasion de revisiter son sujet favori – les outcasts. En ajoutant cette fois à son rôle principal une bonne dose de lose, avec un Josh O’Connor qui multiplie les choix osés pour sa carrière. De quoi former le cocktail parfait pour une réussite ?
« Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney (Josh O’Connor) décide de se reconvertir dans le trafic d’œuvres d’art. Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape : écouler les œuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour. »

(Not) Showing up
Ces dernières années, Kelly Reichardt a acquis une reconnaissance qui fait de ses films indépendants, de manière presque antinomique, de petits évènements. Servie par des castings plus prestigieux et sélectionnée dans des festivals plus importants, la réalisatrice n’en arrête pas pour autant de poursuivre, à travers son genre préféré de la fresque historique, sa dissection des John Doe d’Amérique, ces personnages aussi normaux qu’insignifiants dont elle réussit, la plupart du temps, à en extraire une certaine empathie.
D’empathie, justement, voici ce dont manque son dernier film. « Mastermind » de rien du tout, le personnage campé par Josh O’Connor subit pathétiquement les évènements de la seule manière que sa personnalité de loser lui permet, à savoir en faisant une fuite en avant. Constamment dépassé, JB Mooney organise des casses de bas étage et s’engage dans une cavale dont on peine à ressentir les enjeux.
Peu aidé par un scénario qui ne lui donne pas assez de portée pour l’émotion, Josh O’Connor ne réussit pas à lui seul à élever le film et à nous sortir d’un état de torpeur et d’ennui que seule la toute dernière scène viendra briser (nous y reviendrons). Aride et rigide, The Mastermind est l’œuvre la moins réussie par Reichardt ces dernières années, que l’on sent autant à bout d’inspiration que son personnage est, physiquement et métaphoriquement, à bout de souffle.
La Dernière piste
Apathique dans son scénario comme dans son jeu d’acteurs, The Mastermind n’est pas non plus un tour de force de mise en scène. À l’image des éléments cités plus haut, Kelly Reichardt donne le sentiment de tourner en rond sans quitter la piste de ses films précédents. On y voit, par exemple, les mêmes mouvements de caméra, utilisés dans tous ses tournages sans forcément rechercher à les lier au propos.
Cela donne un film à deux voire trois vitesses, entre une mise en scène qui prône la lenteur, un scénario qui la force, et un jeu d’acteur qui en abuse. Dans cet ensemble d’éléments mal imbriqués, sauvons tout de même une bande-son qui puise intelligemment dans des inspirations de jazz pour donner au film une patte paranoïaque, correspondant pour le coup parfaitement à l’époque hallucinée qu’a été la décennie 1970 aux États-Unis.
Dans ce tableau faisant la part belle à l’immobilisme, que ce soit dans la réalité du film ou la nôtre, seule l’ultime scène dit véritablement quelque chose. On voit Kelly Reichardt se désintéresser soudainement de son personnage (forcément perdant, quoi qu’il arrive), pour dresser en quelques secondes et un plan fixe un portrait immensément cynique et presque nihiliste de l’Amérique, qui n’a pas bien changé depuis. Toujours aussi violente et portée par un appareil sécuritaire qui s’en délecte, l’Amérique du Mastermind et celle de 2026 se retrouvent dans le dernier plan de Kelly Reichardt, qui dit tout d’un seul geste, en cinq secondes plus impactantes que tout le reste du film.

Raté dans les grandes largeurs, The Mastermind est pour Kelly Reichardt le film de la redite et de la paresse. Il n’en reste pas moins intéressant par sa dernière scène qui, tout en donnant l’impression d’être tirée d’une autre œuvre, vient donner à l’ultime marque une toute autre saveur à l’épopée de Josh O’Connor. Big Brother is always watching.