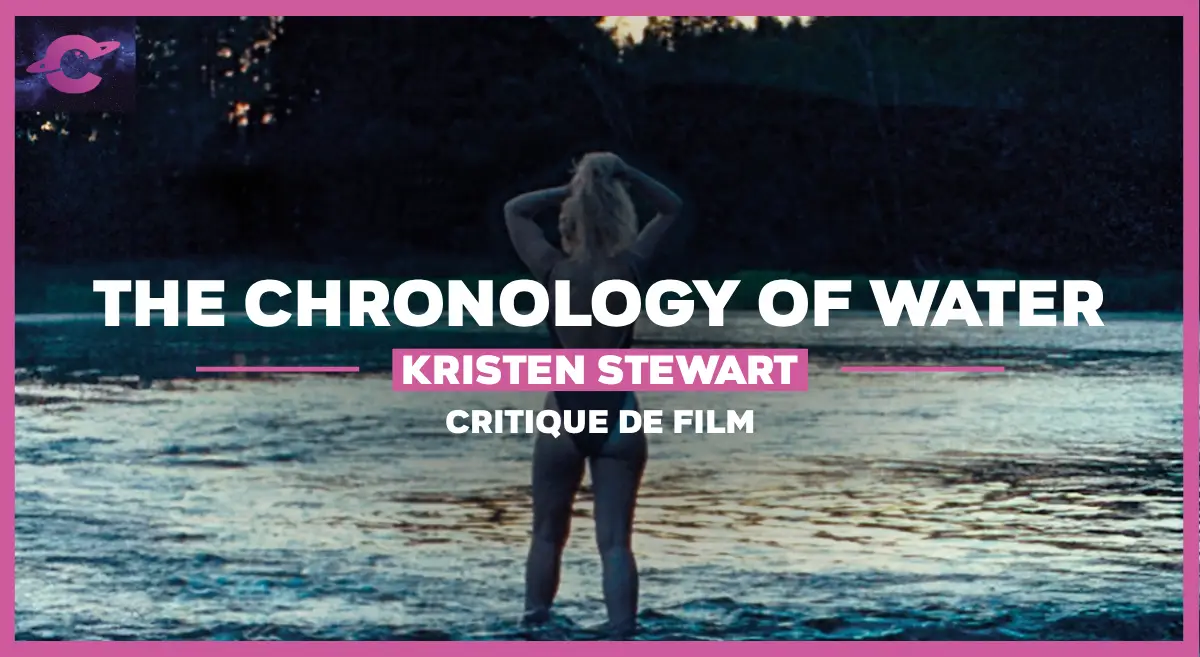The Chronology of Water est le premier long métrage de l’actrice césarisée Kristen Stewart. Le film est sélectionné dans la catégorie Un certain Regard du Festival de Cannes 2025 ainsi qu’au Festival de Deauville 2025, où il remporte le Prix de la Révélation.
Kristen Stewart réalise The Chronology of Water après huit années d’écriture et réécriture. Véritable expérience visuelle, le film est une adaptation de l’autobiographie La Mécanique des fluides de Lidia Yuknavitch, qui explore avec intensité les traumatismes intergénérationnels hérités et transformés.
» Ayant grandi dans un environnement ravagé par la violence et l’alcool, Lidia (Imogen Poots), une jeune femme, peine à trouver sa voie. Elle parvient à fuir sa famille et entre à l’université, où elle trouve refuge dans la littérature. Peu à peu, les mots lui offrent une liberté inattendue… »

Chaos disparate
The Chronology of Water met en scène les manipulateurs et leurs victimes, à différents stades de leur vie. L’abus verbal y est aussi récurrent que l’abus physique. Kristen Stewart choisit ainsi de redonner aux mots leur importance et leur poids. Son film se divise en plusieurs actes afin de dépeindre l’histoire de Lidia. La réalisatrice lui incorpore des flash forward et des flash back, décousant ainsi d’une continuité qui aurait affaibli conséquemment l’impact du récit. L’autrice avait d’ailleurs utilisé ce procédé dans son ouvrage.
Les cinq actes du film symbolisent divers principes : la préparation à la noyade, à l’évasion, au silence, à la réalisation puis au désir de réhabilitation. Autant d’étapes qui évoquent aussi le processus de deuil. Lidia doit-elle mettre fin à ses jours afin d’échapper à un destin qui semble déjà tout tracé ? Ou bien est-il nécessaire qu’elle enterre son soi du passé ?
L’enchaînement entre ces actes est aussi fluide que la mouvance de Lidia dans l’eau, qui se déploie ici sous diverses formes : piscine, mer, baignoire. Chacune représente un refuge ou un moyen de fuite indispensable au maintien psychologique du personnage principal. Cet instrument de survie, multiplié par Kristen Stewart, suggère une certaine dépendance symbolique où Lidia ne semble pas pouvoir progresser sans se laisser submerger.
Effluve ardente
Quelques minutes suffisent pour constater l’identité unique que Kristen Stewart insuffle à ce récit. Les plans, majoritairement très rapprochés et erratiques, permettent de ressentir les douleurs expérimentées par cette protagoniste désabusée, mais créent aussi une impression d’étouffement. Les non-dits sont aussi profonds que les regards filmés : Imogen Poots est tout simplement transcendante et s’investit avec puissance dans la retranscription de l’histoire de Lidia.
Que ce film, qui traite des violences verbales et physiques subies par une femme depuis son enfance, soit écrit et réalisé par une autre femme, lui confère une tendresse indéniable. La caméra 16mm, intimiste, permet ainsi d’aborder des sujets lourds de conséquences, sans verser dans le choc ou le sensationnel. Toutes les actions déterminantes dans l’évolution de Lidia sont suggérées plutôt que montrées, ce qui évite de tomber dans un voyeurisme malaisant.
Cette esthétique est d’autant plus troublante, que la beauté de cette fine pellicule s’oppose à la violence des abus densément répétés. Loin de toute tentative de romantiser la dépression et l’addiction qui découlent inexorablement de ces traumatismes, Kristen Stewart leur confère une résonance tonitruante. Le son, assourdissant, brouille les frontières entre le réel et l’imaginaire.
La fabrique des « maux »
Kristen Stewart donne également vie à une intention essentielle de Lidia Yuknavitch : célébrer le corps de la femme et toute sa physicalité, à la fois forte et vulnérable. De ce fait, le regain de contrôle sur sa sexualité, aussi hétéroclite que possible, est une étape décisive dans la réappropriation de son être. Lidia devient maîtresse de son désir physique et refuse de trouver une forme de normalité dans les douleurs qui l’ont marquée au fil des années.
En couchant ses déboires et ses émotions sur papier, Lidia prend conscience de l’impact destructeur de son passé. Par la surutilisation de monologues ésotériques, constituant le fil rouge principal du récit, la réalisatrice démontre toute la puissance philosophique des mots et des maux. Les véritables dialogues ne surgissent qu’aux rares instants de clarté que Lidia détient sur sa vie. Cette disparité entre monologues et dialogues crée toutefois des longueurs, et le récit tortueux souffre de ce rythme lent, qui peut provoquer un désintérêt progressif du spectateur. Contrairement à une Greta Gerwig, figure actuelle de la réalisation exploratrice féminine, qui confère moins de lourdeur aux questionnements incessants de sa Lady Bird.
The Chronology of Water est un premier long métrage très ambitieux qui bénéficie d’un savoir faire technique captivant afin d’honorer un parcours de vie singulier. Une sincérité artistique incontestable, qu’elle séduise ou non.