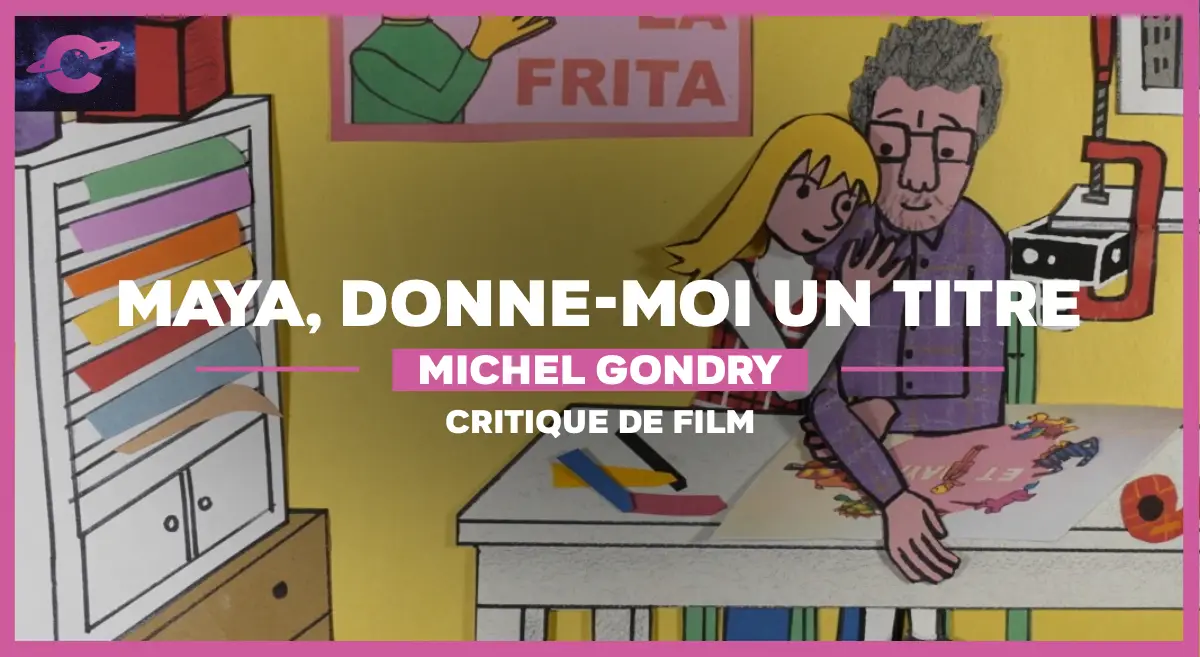Avec Maya donne-moi un titre, Michel Gondry renoue avec le film de commandes.
Michel Gondry aurait-il de nouveau besoin d’argent ? Heureusement, non. Car ce n’est pas un producteur fortuné qui lui a commandé un film à gros budget – on cauchemarde encore du Green Hornet. Non, ce coup-ci c’est… sa propre fille. Maya, 8 ans, qui lui a donné des high concept pitch. Comme on raconte une histoire aux enfants avant d’aller dormir, Michel Gondry en a fait Maya donne-moi un titre, son premier long métrage d’animation.
« Maya et son papa Michel vivent dans deux pays différents. Pour maintenir le lien avec sa fille et continuer à lui raconter des histoires, son papa lui demande chaque soir « Maya, donne-moi un titre ». À partir de ce titre, il lui fabrique alors un dessin animé dont elle est l’héroïne et Pierre Niney, la voix-off. »

La Casa de papel
Pour comprendre la gentille originalité de Maya, donne-moi un titre, il est sans doute utile de remonter au dernier succès public et critique de Gondry : Le Livre des solutions. Dans cette autobiographie en forme d’introspection, le réalisateur français se mettait en scène sous les traits de Pierre Niney, en démiurge agité et incapable de terminer son propre long métrage. De procrastination en refus d’obstacle, il passait son temps à le perdre, et à créer, notamment, des courts métrages d’animation en papier, carton et stop motion. Formellement, Maya donne moi un titre serait donc un long spin-off de ces courts. Vous suivez ?
L’évolution amusante ici, c’est que le scénariste de ces films n’est plus Michel Gondry, mais Maya Gondry. Le processus est enfantin : la jeune Maya donne des scénarii à Michel, par exemple : « La mer est remplie de ketchup, il faut la nettoyer ». On ne se moque pas : on a vu des blockbusters avec un pitch moins travaillé que ce dernier. Michel l’anime. Pierre Niney fait le doublage. Cela donne tout un film réalisé avec un budget à peu près équivalent à 4 ramettes de papier Canson. Un rêve de producteur.
Non-stop emotion
Surréalisme et onirisme sont consubstantiels de Gondry, et on pourrait s’étonner qu’il ne vienne à l’animation qu’au bout de son 10e long métrage de fiction. Ce serait oublier qu’il a toujours essaimé dans ses films, des capsules d’animation ou autres practical effects sortis tout droit de son crayon. Du véritable travail d’artisan, davantage même qu’une oeuvre d’artiste. Ses influences revendiquées lorgnent logiquement vers des poètes du stop-motion, le marionnettiste tchèque Pojar, ou l’ébéniste russe Norchteïn, à l’audace formelle protéiforme.
Cet artisanat du papier, qui part de l’œil vers la main sans passer par l’ordinateur, constitue une impasse aussi anachronique que réjouissante. Certes, Maya n’est pas (encore) Harold Pinter, et ses innocentes histoires finissent par se ressembler un peu toutes. Mais malgré cela, le spectateur demeure constamment dans l’attente des trouvailles visuelles aussi cheap qu’inventives de papa Gondry pour adapter son texte aussi fidèlement que possible. Et même si Pierre Niney ne fait pas suffisamment usage des extraordinaires modulations de sa voix de narrateur pour que nous échappions à une impression de redondance, le film est doté d’une surprenante sensation de vie à mesure que s’envolent les petits papiers.
Cette démarche globale est un joli pied de nez à l’ère de l’IA, ses dessins procéduraux et ses scénarios débités en quelques millisecondes sur ChatGPT. À rebours de l’hyperréalisme des créations en CGI et de leur inquiétante étrangeté, la corporéité naïve des personnages est aussi attachante que réconfortante. C’est à de nombreux égards, mieux que l’enfance de l’art.

Tendre, drôle et parfois un peu trop long, Maya donne moi un titre se révèle, sous ses allures de film mineur, comme un condensé sur papier de l’essence du cinéma de Michel Gondry.